Deux poètes, après Auschwitz
Par Nicolas Weill
LE MONDE - Nadwah - Hong Kong - 20 September
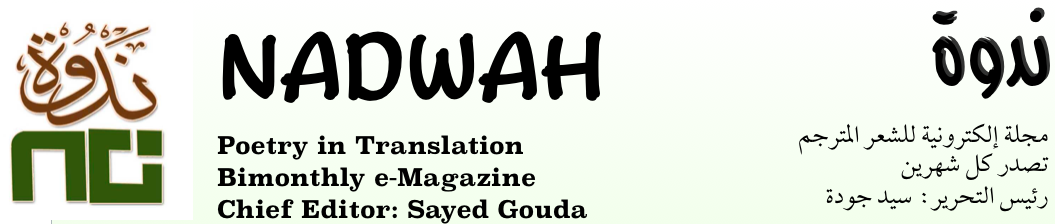 |
|
|
|
|
|
|
| Poésie | Poésie en traduction | Nouvelles de la culture | Qui somme nous? | Contactez-nous |
Deux poètes, après Auschwitz
Par Nicolas Weill
LE MONDE - Nadwah - Hong Kong - 20 September
En mai 1948, à Vienne, deux jeunes gens dans l'Europe d'après la tempête croisent leur destin de façon improbable : le traducteur et poète Paul Celan (1920-1970), qui arrive de Bucarest, et une poétesse de Klagenfurt (Autriche), Ingeborg Bachmann (1926-1973). Le premier est juif. Ses deux parents ont été assassinés au camp d'extermination de Michailowka (Ukraine). L'autre est une Autrichienne. Son père était nazi depuis 1932 ; mais les écrits de jeunesse d'Ingeborg témoignent de son éloignement précoce d'avec l'esprit du national-socialisme, alors que la guerre fait encore rage.
L'un et l'autre vont compter parmi les plus grands poètes de langue allemande ; l'un et l'autre connaîtront une existence jusqu'à la fin marquée par la dépression, la tragédie ou la folie. Leur idylle viennoise sera de courte durée. Certes, en mai 1948, Ingeborg annonce fièrement aux siens qu'elle vient de rencontrer "le poète surréaliste" Paul Celan. Mais ce dernier émigre à Paris en juin de la même année. Dès lors, leur relation sera marquée par l'absence, ponctuée de retrouvailles épisodiques au gré des événements de la vie littéraire allemande d'après guerre, dont cette manne épistolaire (195 lettres conservées qui couvrent une période s'étendant de 1948 à 1963) récemment exhumée constitue un excellent reflet. Une conférence sur la critique littéraire à laquelle ils assistent tous deux à Wuppertal redonne vie à leur liaison amoureuse pendant quelques mois, seulement entre 1957 et 1958. Mais, cette fois, c'est Ingeborg qui rejette Celan, l'adjurant de ne pas abandonner sa femme, l'artiste Gisèle de Lestrange, que ce dernier a rencontrée en 1952, et son fils Eric.
"QUI SUIS-JE POUR TOI ?"
Cette histoire tumultueuse n'était pas inconnue. Mais la publication, cet été chez Suhrkamp, de cette correspondance en restitue tous les méandres. Avec succès, puisque le livre figure encore en bonne place sur la liste des best-sellers de l'hebdomadaire Der Spiegel. On y trouve aussi les lettres que s'enverront - de 1957 à 1973, en français - Ingeborg Bachmann et Gisèle de Lestrange, qui pleureront ensemble le suicide de Celan, ainsi que les échanges épistolaires entre celui-ci et l'écrivain suisse de langue allemande Max Frisch, compagnon d'Ingeborg de 1958 à 1962, dont elle se séparera dans une atmosphère d'effondrement psychique qu'évoque le roman de Bachmann Malina. Dans ce récit crypté datant de 1971, Ingeborg parle aussi de la mort de Celan en établissant un lien entre son suicide - il se jeta dans la Seine - et le trajet des déportés vers les camps : "Ma vie est à son terme, car il s'est noyé dans le transport du fleuve, il était ma vie. Je l'ai plus aimé que ma vie." L'atmosphère de cette correspondance se ressent indéniablement des drames passés et à venir. Elle révèle aussi une grande tendresse, notamment de la part d'Ingeborg. Assez étrangement, la perspective se renverse de lettre en lettre. Celan adopte au début un ton parfois quasi paternel. Ingeborg parle, elle, d'aller contempler avec lui la Seine jusqu'à "devenir petits poissons". Mais, à la fin, c'est elle qui tentera de calmer un Celan devenu de plus en plus impulsif. Les deux amants se soutiennent dans le monde des lettres d'outre-Rhin, où l'antisémitisme s'est métamorphosé plutôt qu'il n'a disparu et qui n'accueille pas à bras ouverts un poète plaçant la Shoah au centre de son écriture. La lecture publique de la célèbre Fugue de mort (Todesfuge) devant les écrivains du "groupe 47", en 1952 à Niendorf, sera un fiasco - certains osant comparer la diction de Celan à celle de Goebbels... A partir de 1953, Celan se voit en outre exposé à une lancinante accusation de plagiat par la veuve du poète surréaliste Yvan Goll, brièvement fréquenté à son arrivée à Paris. Le reste de son existence sera soumis au harcèlement de Claire Goll, dont les diffamations sont relayées par certains critiques. En confiant à Bachmann que Todesfuge constitue pour lui l'"épitaphe" de sa mère ("Grabschrift"), Celan vivra cette offensive comme une profanation antisémite à peine larvée. Ingeborg est l'une des rares à l'appuyer publiquement. Insuffisamment à ses yeux. "Qui suis-je pour toi ?", lui demande Bachmann désespérée, en 1961. Faut-il voir, comme la poétesse et romancière Ulla Hahn (Frankfurter Allgemeine Zeitung du 30 août), dans cette correspondance, l'histoire de l'émancipation progressive d'une femme soumise de la dépendance d'un homme légèrement dominateur, voire manipulateur ? C'est oublier un peu vite qu'entre eux s'impose aussi la dimension du témoignage. Celle-ci ne rend pas que la poésie difficile, sinon "barbare", après Auschwitz. L'amour ou la vie aussi. INGEBORG BACHMANN/PAUL CELAN. HERZZEIT (BRIEFWECHSEL). Edité par Bertrand Badiou, Hans Hِller, Andrea Stoll et Barbara Wiedemann,. Suhrkamp Verlag, 400 p., 24,80 €.
|
|
|
|
 |
 |